La deuxième partie des Provinciales débute par trois brèves allégories :
Le Printemps : « C’était le printemps, frère de l’été. Vous n’auriez pas su distinguer le blé du gazon, ni l’amitié de l’amour ; le ciel était lointain, et montait jusqu’au soleil ; les haleines des hommes ne ternissaient plus l’air, et ne s’y continuaient pas comme une rivière boueuse dans un fleuve transparent ; les trains seuls, à l’horizon, fumaient ; c’étaient les pluies fines tombant de l’azur comme si midi avait sa rosée ; c’était un petit ruisseau, amoureux de son eau, et qui courait après elle, murmurant en vain des noms. »
La Nostalgie : « Ô Nostalgie, adieu ! ma lampe s’est allumée d’elle-même, là-bas, et mon chien m’attend, allongé en sphinx devant la porte qu’il ne comprend plus. Adieu. » « Adieu, toi qui nous enveloppes dans le souvenir comme dans la robe de Nessus, qui poses tes mains à tout moment sur nos oreilles de sorte que nous n’entendons le bonheur que par bouffées incohérentes, pareils à des enfants espiègles quand jouent les orgues. »
À l’amour, à l’amitié : « Il n’y a plus d’amitié ; il n’y a plus, amie, d’amour ; il n’y a plus, sur ta robe, sur ton visage, qu’un miroitement et qu’un rayonnement sous lequel tu tremblotes toute. »
Ces poèmes en prose sont suivis de La Pharmacienne, histoire amusante de la mésaventure d’un agent voyer (de la voirie) qui, voyant mal, s’était trompé de femme…
Claude Monet, La Grande Creuse au pont de Vervy (1889).








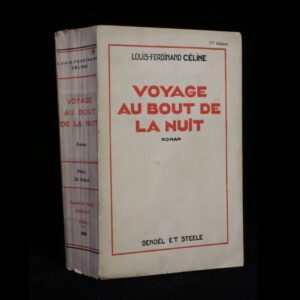

Ajoutez un commentaire !
C'est la meilleure manière de remercier les donneurs de voix.